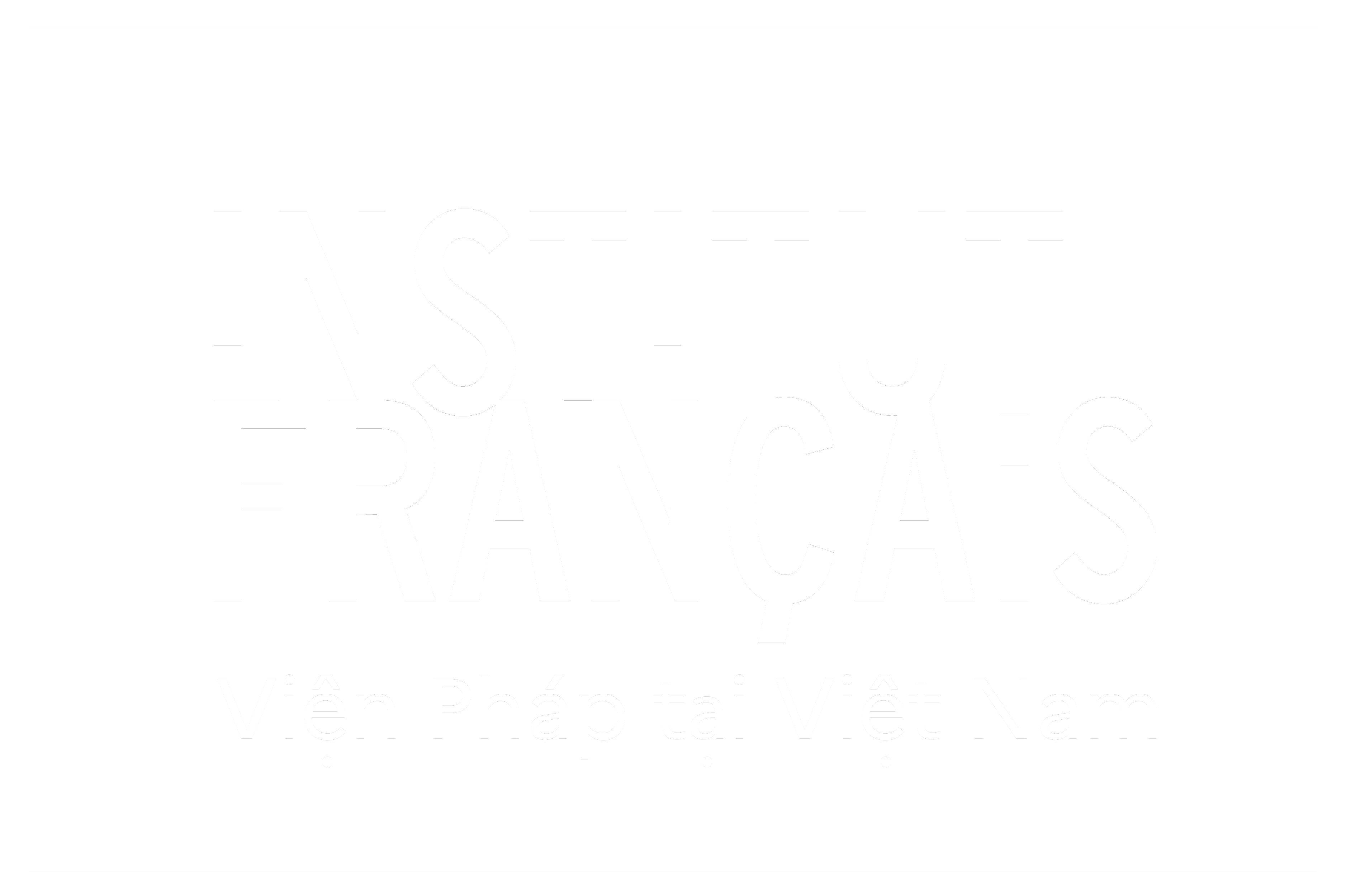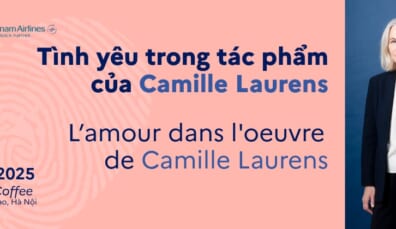Vers un mode de vie sobre : quels enjeux pour les consommateurs ?
Conférence
Intervenante :Valérie GUILLARD, Docteur en Sciences de Gestion, Professeur à l’Université Paris Dauphine
Le réchauffement climatique global conduit la société civile (citoyens, organisations non marchandes), les intellectuels mais aussi certains gouvernements (notamment en France) à orienter les modes de vie vers davantage de sobriété. Le GIEC définit la sobriété comme « un ensemble de mesures et de pratiques quotidiennes qui permettent d’éviter la demande d’énergie, de matériaux, de terres et d’eau tout en assurant le bien-être de tous les êtres humains dans les limites de la planète » (GIEC, 2022). La sobriété concerne autant la consommation de produits alimentaires ; d’objets et de services ; de numérique ; les bâtiments ou encore les territoires, toutes ces dimensions ayant pour point commun l’énergie. Transformer son mode de vie vers le moins et le mieux, autrement dit pour une consommation qui répond à des besoins et qui est la moins destructrice du vivant implique de changer un ensemble de pratiques quotidiennes. Dans quelle mesure les consommateurs consentent-ils à transformer leur mode de vie vers davantage de sobriété ? Le seul consentement suffit-il à changer les pratiques de consommation ? Pour quelles raisons certains consommateurs éprouvent-ils des difficultés à adopter un mode de vie sobre ? Différentes raisons matérielles, économiques, matérielles seront évoquées et expliquées mais également le rapport au temps. Substituer la voiture par la bicyclette ; les plats surgelés par l’achat de légumes ; la réparation plutôt que le remplacement des objets questionne le rapport au temps et son corolaire le travail, deux thèmes que nous discuterons dans cette conférence.
Enfin, la sobriété des modes de vie pose des questions de justice sociale. En effet, les produits moins destructeurs du vivant sont souvent plus coûteux que ceux de moins bonne qualité et qui ne sont pas produits localement. Quels consommateurs font quels arbitrages en faveur de ces produits ? De plus, ces produits dits « durables » ou « éthiques » font également l’objet de moins de dons caritatifs par les entreprises ou les particuliers. Certaines associations redistribuent par le don des produits qui ne s’inscrivent pas dans un mode de vie sobre et pourtant qui nourrissent et/ou fournissent les consommateurs en situation de précarité. Faut-il repenser l’acte de donner et au-delà la solidarité à l’aune de la sobriété des modes de vie ?